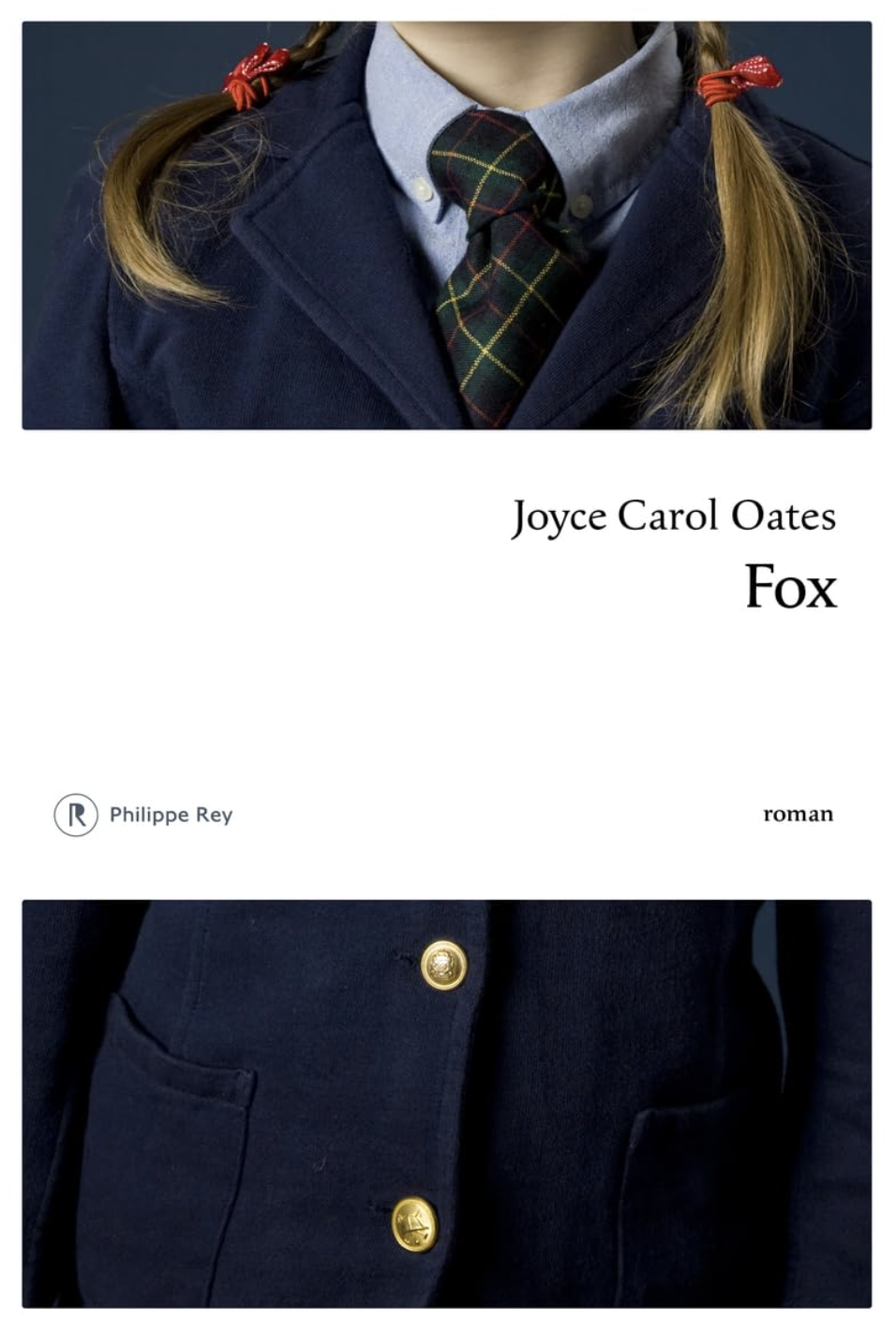Philippe Jaenada : le grand mâle à l'esprit d'escalier
- Écrit par : Guillaume Chérel
 Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.fr/ "La Petite Femelle", telle une enquête policière, retrace la quête obsessionnelle que Philippe Jaenada a mené pour rendre justice à Pauline Dubuisson en éclairant sa personnalité d'un nouveau jour. Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la France entière réclame la tête ? Une arriviste froide et calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands, a été tondue, avant d'assassiner par jalousie un garçon de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire, qu'une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son émancipation et questionne la place des femmes au sein de la société ? Personne n'a jamais voulu écouter ce qu'elle avait à dire, elle que les soubresauts de l'Histoire ont pourtant broyée sans pitié. À son sujet, comme il l’avait fait pour « Sulak » (Julliard), son précédent livre, Philippe Jaenada a tout lu, tout écouté, soulevé toutes les pierres. Il nous livre ici un roman minutieux et passionnant, auquel, avec un sens de l'équilibre digne des meilleurs funambules, il parvient à greffer son humour irrésistible, son inimitable autodérision et ses cascades de digressions. Un récit palpitant, qui défie toutes les règles romanesques. Nous l’avons rencontré pour lui poser les questions que se pose son public, de plus en plus nombreux, depuis son Prix de Flore pour « Le Chameau sauvage », en 1997.
Par Guillaume Chérel - Lagrandeparade.fr/ "La Petite Femelle", telle une enquête policière, retrace la quête obsessionnelle que Philippe Jaenada a mené pour rendre justice à Pauline Dubuisson en éclairant sa personnalité d'un nouveau jour. Au mois de novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son amant. Mais qui est donc cette beauté ravageuse dont la France entière réclame la tête ? Une arriviste froide et calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands, a été tondue, avant d'assassiner par jalousie un garçon de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire, qu'une jeune fille libre qui revendique avant l'heure son émancipation et questionne la place des femmes au sein de la société ? Personne n'a jamais voulu écouter ce qu'elle avait à dire, elle que les soubresauts de l'Histoire ont pourtant broyée sans pitié. À son sujet, comme il l’avait fait pour « Sulak » (Julliard), son précédent livre, Philippe Jaenada a tout lu, tout écouté, soulevé toutes les pierres. Il nous livre ici un roman minutieux et passionnant, auquel, avec un sens de l'équilibre digne des meilleurs funambules, il parvient à greffer son humour irrésistible, son inimitable autodérision et ses cascades de digressions. Un récit palpitant, qui défie toutes les règles romanesques. Nous l’avons rencontré pour lui poser les questions que se pose son public, de plus en plus nombreux, depuis son Prix de Flore pour « Le Chameau sauvage », en 1997.
Pourquoi écrivez-vous ?
Je me la suis posée dans tous les sens, cette question. Ce n’est pas par plaisir en tout cas. Ce n’est pas une corvée non plus, mais c’est du travail. J’entends parfois des auteurs dire que, pour eux, écrire est un « bonheur » de chaque jour. Qu’ils ont « absolument » besoin d’écrire tous les jours, que l’écriture est pour eux comme l’eau pour les poissons, ou l’air pour les hamsters… Moi c’est pas ça. Ce n’est ni pour le fric ni pour la notoriété. Ça ne me plairait pas d’être trop connu. J’aime ma tranquillité. A mon petit niveau, j’ai eu le tort de donner l’adresse de mon bar préféré et parfois ça m’embête d’avoir à parler à des gens que je ne connais pas et qui se sont déplacés pour me voir. Je n’envie pas des auteurs plus connus. Il y a deux raisons, pour lesquelles j’écris, je crois : je ne suis pas à l’aise en société. En écrivant, je peux m’exprimer librement sans personne en face de moi pour m’intimider ou me juger. Mais la principale raison, je pense, c’est que j’aime tellement lire que je pense avoir écrit par reconnaissance envers ce plaisir de lire… Je préfère lire qu’écrire. Je veux donc participer à ça. C’est ma manière de rendre la monnaie de leur pièce aux auteurs qui me passionnent. Et puis, même si ça peut paraître un peu pathétique, je devais avoir besoin d’être aimé aussi…
Comment avez-vous commencé ?
Je suis un ancien matheux. Un jour, j’ai réalisé que j’en avais rien à faire des maths et je me suis enfermé un an chez moi. Je suis devenu très solitaire. Après cette période, j’ai passé des années sans téléphone, sans télé, sans radio. Encore aujourd’hui je n’ai pas de téléphone portable et le fixe me donne des boutons quand il sonne. Bref, le premier texte que j’ai écrit, c’était cette année non pas de dépression mais de pétage de plomb. Je me faisais tellement ch… Je ne parlais à personne. J’avais dit à mon entourage que je faisais une expérience… Avant de commencer à écrire, vers 1988, je m’automutilais, me brûlais les doigts avec mes clopes. Je faisais des tests tous plus idiots les uns que les autres, comme ne plus manger pendant une semaine, ne pas dormir pendant une semaine, ne boire que du café au lait pendant un mois ! Un jour, je me suis mis du scotch sur la bouche pour n’avoir qu’une paille dans la bouche. J’avais 23 ou 24 ans et ça n’allait pas du tout. J’ai eu beaucoup de mal à passer de l’adolescence à l’âge adulte. Sans l’écriture, je finissais en HP. Ma vie était vide. Je m’étais obligé à ne plus communiquer avec les autres. Sauf quand j’ai décidé d’écrire à mes rares amis et à ma famille, pendant des années, puisque je n’avais pas le téléphone. Il n’y avait pas Internet à l’époque. J’écrivais des pages dans les cafés destinées à mon entourage. C’est là que j’ai utilisé les parenthèses parce que je racontais ma vie, au fil de ma plume, sans construction ni ambition littéraire.
Quel était le genre du premier texte que vous avez écrit ?
Une nouvelle que j’ai montrée à un pote. Il était stagiaire à l’Autre Journal, dirigé par Michel Butel. C’était un texte qui se voulait littéraire, académique mais aussi original : très mauvais en fait. J’avais lu une phrase de Deleuze, qui disait : « Un bon écrivain, c’est celui qui écrit comme un étranger dans sa langue. » Et moi j’avais mal compris. Je croyais qu’il fallait que je me décale de ma propre langue. C’était débile. Ce n’est que six ou sept ans plus tard, quand j’ai écrit « La Chameau sauvage », que je me suis libéré. J’ai écrit au plus proche de ce que j’étais. J’essaie d’être fidèle à ce que je pense. Je me suis débarrassé des effets de plumes pompeux. Et c’est là que j’ai pensé utiliser ma technique de la parenthèse, qui est devenu ma marque de fabrique. Ce n’est pas une pose. C’est naturel. J’essaie de ne pas en abuser. Mais c’est mon moyen de m’exprimer. Ça donne plusieurs niveaux de lecture, ou couleurs, comme en peinture. J’ai l’esprit d’escalier…
Auriez-vous des conseils à donner à l’auteur que vous étiez, et à ceux qui veulent écrire ?
L’essentiel c’est de travailler. D’écrire, quoi. On ne peut pas devenir sauteur à la perche si l'on ne s’entraîne pas. Il ne faut pas attendre l’inspiration mais s’asseoir et écrire. Pour le premier livre publié, je m’étais enfermé à la campagne et ai donné des centaines de pages en huit mois. Il n’y a pas de secret. Chacun a sa méthode. La mienne est d’être régulier, presque scolaire. Tous les jours à 10 h 30, je m’asseois à ma table de travail et j’écris. Je déjeune, je sors un peu et je remets ça à 15 h. Pendant un ou deux ans. Ce n’est pas une vie très passionnante. Ils me font marrer, ces auteurs qui sortent leur ordinateur portable pour écrire dans le train de retour de salon littéraire… Alors qu’en général on a trop bu : ça ne peut donner que de la daube. Ma vie est monacale. Je ne picole pas quand j’écris, je n’écoute pas de musique en écrivant. Je suis concentré. Avant, j’écrivais la nuit. Mais maintenant que je suis un vieux schnock, qui a une vie de famille, je ferme les volets, je fais brûler une bougie, pour me donner l’impression que c’est la nuit. Il ne faut pas que je bouge beaucoup. Si je dois bouger, en promo (salons littéraires) ou parler (télé, radio) ça me déconcentre et me perturbe pour écrire. J’ai besoin d’un environnement sécurisant. Ou tout est pareil, régulier, chaque jour pendant des mois. C’est pour ça que je ne voyage pas. Pour ne pas me disperser.
m’étais enfermé à la campagne et ai donné des centaines de pages en huit mois. Il n’y a pas de secret. Chacun a sa méthode. La mienne est d’être régulier, presque scolaire. Tous les jours à 10 h 30, je m’asseois à ma table de travail et j’écris. Je déjeune, je sors un peu et je remets ça à 15 h. Pendant un ou deux ans. Ce n’est pas une vie très passionnante. Ils me font marrer, ces auteurs qui sortent leur ordinateur portable pour écrire dans le train de retour de salon littéraire… Alors qu’en général on a trop bu : ça ne peut donner que de la daube. Ma vie est monacale. Je ne picole pas quand j’écris, je n’écoute pas de musique en écrivant. Je suis concentré. Avant, j’écrivais la nuit. Mais maintenant que je suis un vieux schnock, qui a une vie de famille, je ferme les volets, je fais brûler une bougie, pour me donner l’impression que c’est la nuit. Il ne faut pas que je bouge beaucoup. Si je dois bouger, en promo (salons littéraires) ou parler (télé, radio) ça me déconcentre et me perturbe pour écrire. J’ai besoin d’un environnement sécurisant. Ou tout est pareil, régulier, chaque jour pendant des mois. C’est pour ça que je ne voyage pas. Pour ne pas me disperser.
Depuis « Sulak » (Julliard), vous avez décidé de ne plus vous inspirer de votre vie personnelle, c’est bien ça ?
Oui, j’en avais marre de raconter ma vie, d’une part : c’était comme si je rentrais chez moi par la fenêtre. Et d’autre part, je n’avais plus rien à raconter. Je suis resté cinq ans sans écrire… Je vis en vase-clos avec ma femme et mon fils. Je vis dans une bulle. Ma seule fenêtre vers l’extérieur, c’est quand j’écris… Et quand je travaille pour gagner ma croûte. Je n’ai jamais eu envie d’arrêter mais j’ai cru que c’était mort. Comme je ne sais pas inventer, j’ai pensé me nourrir de la vie des autres. Ça a donné « Sulak » et « La Petite femelle ». Tout ça ne me rapporte pas grand-chose. Si je n’avais pas mon boulot de réécriture à Voici, je serai dans la merde financièrement. Je ne vends pas assez de livre pour en vivre correctement. Et les adaptations télé, ou ciné, qu’on me propose je les refuse parce que je pense que ça tuerait le livre, parce que les images, les visages et les décors, sont désormais amalgamés au texte, imposés. Ce qui, selon moi, est contre-nature, pour la littérature. Regardez « 37°2 le matin », de Philippe Djian : si on a vu le film, on n’a pas envie de lire le livre. « Sulak » sera adapté au cinéma, mais le sujet ne m’appartient pas, donc je ne pouvais pas refuser.
Après toutes ces années d’écriture, et de publications, est-ce que vous dégagez une thématique de votre « œuvre » ?
On me dit « les femmes », ma femme… Mais je pense que c’est surtout le thème de la chute. Il y a cette constante : ce sont des gens qui dégringolent. Moi, quand je parlais de moi. Puis Sulak, Pauline Dubuisson, dans « La Petite femelle »… Je ne pense pas que je pourrais écrire sur la vie de Bill Gates. Ce sont des gens qui ont tout pour aller bien mais qui tombent.
Quels ont été vos déclics, ou vos auteurs préférés ?
J’aime énormément d’écrivains différents mais un auteur comme Richard Brautigan m’a fait découvrir qu’on pouvait écrire de manière légère, fantaisiste, tout en étant profond et triste. Voilà un déclic. Comme Charles Bukowski. Le sujet n’a pas tant d’importance que ça. C’est la manière d’écrire qui compte.
Combien de temps prenez-vous pour écrire vos livres?
Avec ma nouvelle méthode d’écriture, sur des personnages ayant existé, je prends environ dix mois pour me documenter et dix mois à un an et demi pour rédiger. Sur « La petite femelle », j’avais 350 pages de doc : ça a donné 700 pages à la fin. Je vais commencer à faire des recherches en janvier, pour mon prochain livre, mais je ne pense pas commencer à écrire avant octobre, soit dans presque un an. J’ai une idée… Encore une histoire de fait-divers. Mais rien de fait.
Le choix de l’éditeur est-il important pour vous ?
Oui, je m’en suis rendu compte. J’ai accepté la proposition de Grasset parce que je pensais que l’éditeur de mes débuts, Julliard, ne vendait pas assez bien mes livres. Comme tous les auteurs, je pensais que c’était de la « faute » de l’attachée de presse, et pas de mes livres… A la signature de mon premier contrat, en 1996, j’’avais dit à l’éditeur : « On va en vendre au moins 100 000 ! ». Il rigolait… Je ne connaissais rien de ce « milieu ». Or, je n’ai pas vendu trois fois plus de livres - en dix ans et quatre livres chez Grasset -, comme on me l’avait promis. A part ça, je n’ai rien à leur reprocher mais Grasset est plus germanopatin que Julliard. C’est moins mon monde, ce côté cocktail, champagne. Chez Julliard/Robert Laffont, c’est davantage pinard et saucisson. Bref, j’avais dit à Julliard que je reviendrai si…. Et Betty Mialet et Bernard Barrault (éditeurs chez Julliard ndla) ont été bien gentils de me reprendre, parce que c’est comme si j’avais dit à ma femme : « Ecoute, chérie, je vais aller chez la voisine quelque temps mais je t’aime toujours, hein, je reviendrai… ». Certains auteurs font risette à tout le monde et travaillent au corps les jurés et les critiques : ils sont copains depuis dix ans. A leur manière, ils « méritent » leur succès puisque, d’une certaine manière, ils ont dépensé une énergie folle à entretenir de bonnes relations. C’est une autre sorte de boulot. Et ils choisissent des sujets porteurs, pour passer à la télé… Moi, parler et me montrer, c’est pas trop mon fort.
La petite femelle
Auteur : Philippe Jaenada
Editeur : Juillard
720 p, 23 euros